La gale acarienne humaine (Scabies en anglais) est classiquement
l'apanage des souches sociales défavorisées. C'est une affection
actuellement toujours fréquente favorisée par les conditions
d'hygiènes précaire et le surpeuplement.
Cycle du parasite :
La gale est une maladie ectoparasitaire due à un acarien, le Sarcoptes
scabiei hominis, qui vit dans la couche cornée de l'épiderme.
Ces acariens font moins de 0,5 mm de longueur et se nourrissent en buvant
le sang de la personne infectée.
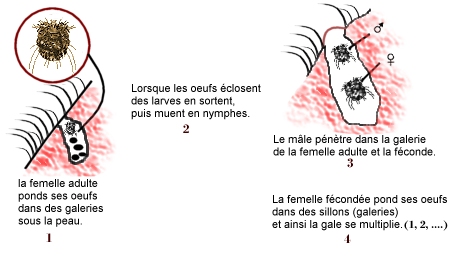
La femelle fécondée y creuse un tunnel ("le sillon
de la gale") et y pond des œufs : environ de 1 à
5 par jour.
Au bout de 4 jours, l'éclosion donne naissance
à des larves qui deviennent matures sur la peau 10 jours
plus tard.
Elle est transmise dans l'immense majorité des cas par contact
inter humain direct. Elle se fait par les femelles fécondées
qui sont noctambules. Le parasite ne survit que quelques
jours en dehors de son hôte.
L'acarien femelle adulte a une bonne mobilité pour des température
de 25 à 30°C ; en dessous de 20°C, il est immobile
et meurt rapidement ; au-dessous de 55°C, il est tué
en quelques minutes.
Ainsi, la gale se transmet par contact :
• direct : chez les personnes partageant le même lit. Possible
aussi lors des rapports sexuels : il s'agit ainsi d'une M.S.T,
• en raison de la fragilité de l'acarien en dehors de son
hôte humain le contact indirect (draps, vêtements infestés)
est une éventualité plus rare.
L'incubation est très variable, de 2 jours (en cas de ré
infestation) à plusieurs semaines (3 semaines en moyenne).
Elle se caractérise par un signe subjectif important : le prurit,
initialement localisé aux régions interdigitales et aux
fesses, il s'agit souvent d'un prurit généralisé
ne respectant que la tête et le dos. Il présente une recrudescence
nocturne, et un caractère conjugal ou familial.
Devant un prurit si caractéristique, on recherchera :
1- Des lésions objectives spécifiques de gale :
- le "sillon scabieux" est pathognomonique,
il se traduit par un trait fin, sinueux, filiforme de 5 à 15 mm
de long : on le recherchera soigneusement entre les doigts et les faces
antérieures des poignets.
- à l'une des extrémités du sillon, on peut avoir
parfois une élevure de couleur nacrée : c'est "l'éminence
acarienne" : elle correspond à la position de la
femelle adulte ; le reste du sillon est occupé par les œufs
pondus.
- Les nodules scabieux sont de grosses papules infiltrées et excoriées
siégeant dans la région axillaire et génitale ("chancre"
scabieux de la verge et au scrotum).
2- Des lésions non spécifiques de la gale :
il s'agit de lésions de grattage, de papules excoriées et
de placards lichénifiés.
Ces lésions de grattage ont une topographie antérieure (à
l'exception des fesses) et symétrique très évocatrice
: ainsi, les lésions siègent dans les espaces interdigitaux,
à la face antérieure des poignets, les coudes, les fesses,
la face antérieure des cuisses.
Chez les femmes, le prurit bilatéral du mamelon et de l'aréole
mammaire avec lésions excoriées et croûteuses est
un signe évocateur. Chez l'homme (organes génitaux : "chancre"
scabieux). Le visage, le cou et le dos sont épargnés.
Nous insisterons sur le fait que les lésions objectives de la gale
peuvent être extrêmement discrètes, notamment chez
les gens propres, parfois tout se résume à un prurit dont
le caractère persistant, parfois familial et nocturne justifie
pleinement un traitement d'épreuve.

Les
démangeaisons sont les premiers signes de cette
maladie parasitaire. C'est le soir au coucher, ou après un bain
chaud, qu'elles sont les plus fortes. Elles peuvent être la cause
d'insomnie.
Lorsque toute une famille se gratte,
il faut penser à la gale avant même qu'il soit possible d'observer
les sillons sous la peau. Puis les sillons apparaissent. À l'extrémité
de ces tunnels, longs de quelques milimètres à deux centimètres,
qui serpentent sous la peau, se forment de minuscules perles translucides,
caractéristiques de la maladie. On les observe surtout entre
les doigts, sur la face antérieure des poignets,
aux plis des coudes, sous les aisselles,
à la ceinture, sur la face interne des
cuisses, sur la partie inférieure des fesses,
sur les aréoles des seins chez la femme, et au
niveau du fourreau ou du gland chez l'homme. Le grattage
provoque alors l'apparition des croûtes.
Chez les personnes immunodéprimées, ou chez les personnes
âgées, la gale prend un aspect particulier. Les lésions
sont plus étendues, recouvertes de croûtes et situées
de préférence au niveau des extrémités. On
lui donne alors le nom de gale norvégienne. Plus les démangeaisons
sont fortes, plus le risque de grattage, donc de surinfection, est important.
Non traité, la gale persiste indéfiniment et peut être
à l'origine de complications qui sont :
• L'impétiginisation des lésions,
• L'eczématisation favorisée par le prurit persistant
et les traitements locaux.
Traitée efficacement, le prurit disparaît le plus souvent
en quelques jours (4 à 5 jours). Parfois, il persiste plus longtemps
mais doit s'atténuer spontanément en 2 à 3 semaines.
Passé ce délai, on envisagera la possibilité d'une
ré infestation ou d'une persistance de l'affection (désinfection
insuffisante).
Le
grattage détruit le sarcopte. Cependant, lors de gale surinfectée
siégeant au niveau génital, on peut confondre la maladie
avec une syphilis ou un chancre mou.
La
gale non-humaine, caractérisée par des démangeaisons
sans sillons, guérit spontanément.
 Ce sont les femelles qui sont en cause dans les démangeaisons.
Lorsqu'elles sont fécondées, elles creusent des
sillons dans l'épaisseur de la peau et y déposent leurs
œufs. Le cycle parasitaire dure 20 jours : après
la ponte, les larves éclosent en quelques jours, deviennent adulte
en deux semaines et vont ensuite se multiplier à la surface de
la peau. La transmission de la gale est alors possible et souvent très
rapide.
Ce sont les femelles qui sont en cause dans les démangeaisons.
Lorsqu'elles sont fécondées, elles creusent des
sillons dans l'épaisseur de la peau et y déposent leurs
œufs. Le cycle parasitaire dure 20 jours : après
la ponte, les larves éclosent en quelques jours, deviennent adulte
en deux semaines et vont ensuite se multiplier à la surface de
la peau. La transmission de la gale est alors possible et souvent très
rapide.
La gale humaine se transmet surtout par contact physique direct, notamment
lors des rapports sexuels : c'est pourquoi la gale est parfois classée
parmi les infections sexuellement transmissibles. La maladie est très
contagieuse car le parasite peut survivre environ un à deux jours
en dehors de son hôte, dans les draps ou les vêtements par
exemple, mais parfois plus, suivant les conditions d'humidité et
de température, ou la présence dans des squames détachées
de la peau. La contagion semble être plus grande durant la saison
froide.
Par sa localisation (dans les sillons), le sarcopte résiste aux
mesures hygiéniques habituelles (bain, savonnage). Le parasite
est immunogène : il déclenche une réaction immunologique
et c'est cette dernière qui est responsable des démangeaisons
(prurit) et des lésions de la peau à type d'urticaire. La
ré-infestation est gênée chez un sujet immunisé
mais pas complètement empêchée.
Gale
du nourrisson et de l'enfant :
Elle se caractérise en plus par :
- la présence de nodules scabieux sur le périnée
et les aisselles,
- des lésions papulo-pustuleuses des paumes et surtout des plantes
particulièrement évocatrices,
- l'atteinte du visage à pu être observée
- la gale est volontiers impétiginisée
• 3. La gale norvégienne :
Elle est une variante très rare, mais extrêmement contagieuse
de l'infestation à Sarcoptes scabiei : elle survient avec prédilection
chez les retardés mentaux (mongoliens) et les sujets immunodéprimés
(hémopathies, HIV+... ). Le nombre d'éctoparasites sur tout
le corps est de l'ordre de quelques millions d'acariens : cette multiplicité
de sarcoptes en explique le caractère extrêmement contagieux
(contagiosité permettant un diagnostic rétrospectif lorsque
médecins et infirmiers d'un même service sont tous atteints
d'une gale vulgaire après avoir examiné le malade).
L'aspect est déroutant : le prurit est d'intensité très
variable, modéré ou féroce parfois absent. Les lésions
sont croûteuses et hyperkératosiques et prédominent
sur les zones de pressions (coudes, genoux, fesses) et les extrémités
(paumes, plantes, verge). Les ongles sont épaissis.
Parfois un tableau d'érythrodermie squamo-croûteuse est réalisé
pouvant prêter à confusion avec un psoriasis
TRAITEMENT
Ascabiol (lotion de Benzoate de benzyle)
Benzochloryl (solution de DDT).
Le traitement doit être pratiquer à tous les membres de la
famille si possible !
Il faut badigeonner toute la surface du corps du cou jusqu'aux
pieds, après
un bain savonneux de préférence. Laisser sécher 15mn
puis refaire une nouvelle application, remettre ensuite les mêmes
vêtements. Vingt quatre heures après, sans se laver, faire
une 3ème application et changer de vêtements. Au 3ème
jour bain savonneux.
L'idéal, mais pas toujours possible, faire bouillir tout son linge,
draps, passer au fer chaud les couvertures et les sous-vêtements,
mettre de la poudre DDT (ascapoudre ou aphtiria) sur la literie, les matelas.
Il
faut effectuer le lavage a 60°C de tous les vêtements,
literies, tissus d’ameublement ; ou pour les tissus ne pouvant le
supporter, leur désinfection avec une poudre antiparasitaire (laissée
48h). Pour
les enfant, le contact avec la solution antigale ne doit pas dépasser
12 heures (risques toxicité; convulsion). Le crotamiton (la crème
Eurax* ou prurex* ) une application par jour de 7 à 10 jours, moins
efficace que l'ascabiol pourrait être surtout utile sur les nodules
scabieux des nourrissons.
L'ivermectine, par voie orale, a été testé avec succès
et semble aussi efficace que les applications locales.
Des antibiotiques peuvent être prescrits en cas de surinfection.
Lorsque le malade se gratte trop, des médicaments qui soulagent
les démangeaisons peuvent être utilisés.
En attendant un diagnostic plus fiable, un traitement provisoire, retardateur
de l'infestation, permet alors d'une part de faire cicatriser rapidement
les plaies consécutives au grattage, d'autre part de réduire
la copulation des sarcoptes et donc leur reproduction: les préparations
à base d'un mélange de glycérine et d'allantoïne,
faciles à se procurer dans le commerce, révèlent
en l'occurrence une certaine efficacité, pourvu que le malade ne
soit pas atteint de porphyrie.